Il peut être séduisant d'embrasser la théorie qu'un environnement "optimal" induirait une "absence absolue" d'égoïsme, d'esprit de compétition, de désir de posséder, etc. Mais traiter l'environnement qui influence n'est pas traiter le "mal" à la racine. Premièrement, si nous somme influencés vers l'égoïsme, c'est que nous sommes influençable vers l'égoïsme; une pratique mentale régulière diminuerait voire éradiquerait cette "influençabilité à l'égoïsme", quel que soit l'environnement. Ensuite, même au sein d'un "environnement optimal", elle serait, entre autre, une sorte de garde-fou à l'apparition de toute volition néfaste (égoïsme, désir de posséder, etc.) que l'environnement optimal seul ne pourrait prévenir. Sans compter que, même si la théorie semble parfaite, l'application peut intégrer des "imperfections", des "petites différences par rapport à la théorie" qui éloigneront d'autant plus l'environnement de son optimum.
De plus, ce serait un atout pour mener à bien la stratégie de changement et maintenir l'état "final" voulu, par synergie: un entrainement mental régulier permet de jouer sur les facteurs "amour altruiste", "égoïsme" etc. C'est un deuxième "angle d'attaque" du problème de l'égoïsme, en symbiose avec la question de l'influence par l'environnement. Pourquoi se passer d'un élément qui ne peut être que bénéfique pour atteindre notre objectif ? Sans compter qu'une pratique mentale (en tout cas celle à laquelle je fais référence) est en elle-même réductrice d'émotions négatives et de "tendances internes" néfastes (pour citer les mêmes exemples les plus évidents: égoïsme, désir de posséder, d'entrer en compétition plutôt qu'en coopération etc.), indépendamment de l'environnement; sans oublier que cette pratique induit un sentiment de mieux-être pour chacun, et on sait bien qu'une société va mieux si ses habitants "vont mieux" (il n'est donc pas tant question "d'agir bien" [côté moral] que de se "sentir bien" [il n'est pas question de morale sous cet aspect]). Selon moi, ne jouer que sur le facteur environnement pour atteindre notre objectif de "société d'amour" reste hasardeux et, pour le coup, utopique. On peut même pousser l'analyse jusqu'à dire qu'une pratique mentale régulière (ou son absence) fait "partie de l'environnement" et que c'est un élément sur lequel jouer, une "condition", au même titre que le système économique, le système éducatif, etc.
Enfin, on peut sans se brûler postuler que des êtres ayant un entrainement mental régulier n'auraient pas généré "une telle société", un tel système économique ne prenant pas en compte le bien-être de chacun, l'impact sur l'environnement, etc. (ces préoccupations apparaissent naturellement, ou sont renforcées, avec la pratique de la méditation), ce qui me fait penser que cet aspect de "changement intérieur" prime sur le changement externe (environnement, conditions), dans le sens qu'il devrait, à mon sens, le précéder (non l'exclure, bien entendu). Il est à noter que je ne prétends pas que les êtres ne méditant pas sont dépourvus de ces préoccupations, de cette "moralité", de ce "bien-être" dont je parlais plus haut.
C'est pourquoi je propose d'encourager à une pratique méditative régulière au sein de l'ukratie, pour chacun de ses membres. Après tout, libre à chacun de s'astreindre à une pratique régulière s'il en ressent le besoin et en reconnait les bénéfices multiples (et non limités à sa propre personne); mais cet élément reste selon moi un facteur assez déterminant dans un mouvement de "nouvelle société d'amour", ainsi je voulais attirer votre attention sur ce point.
Qu'en pensez-vous chers amis ?""
Répondre

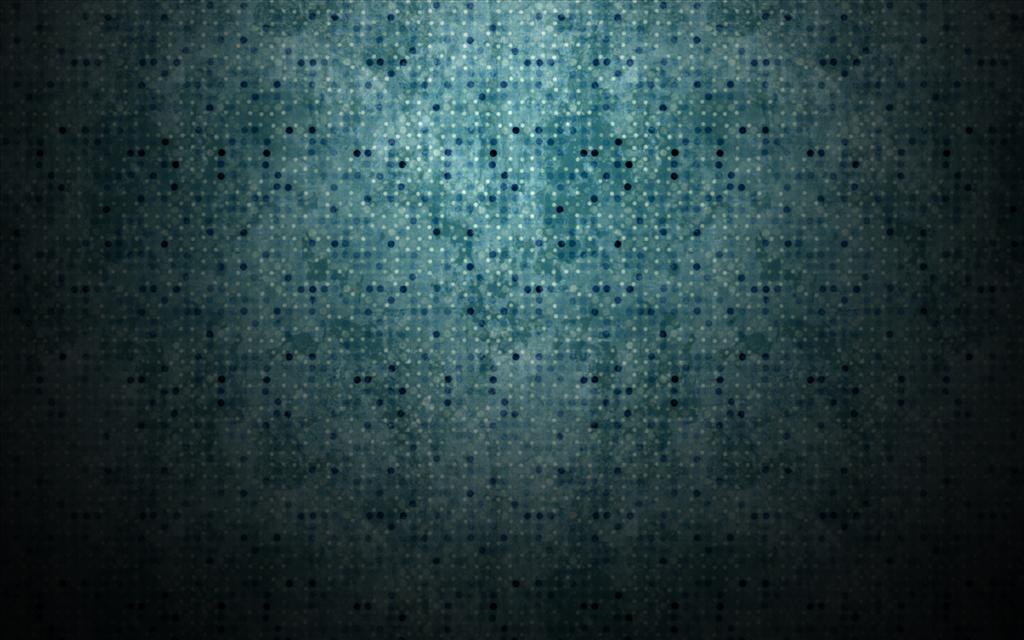
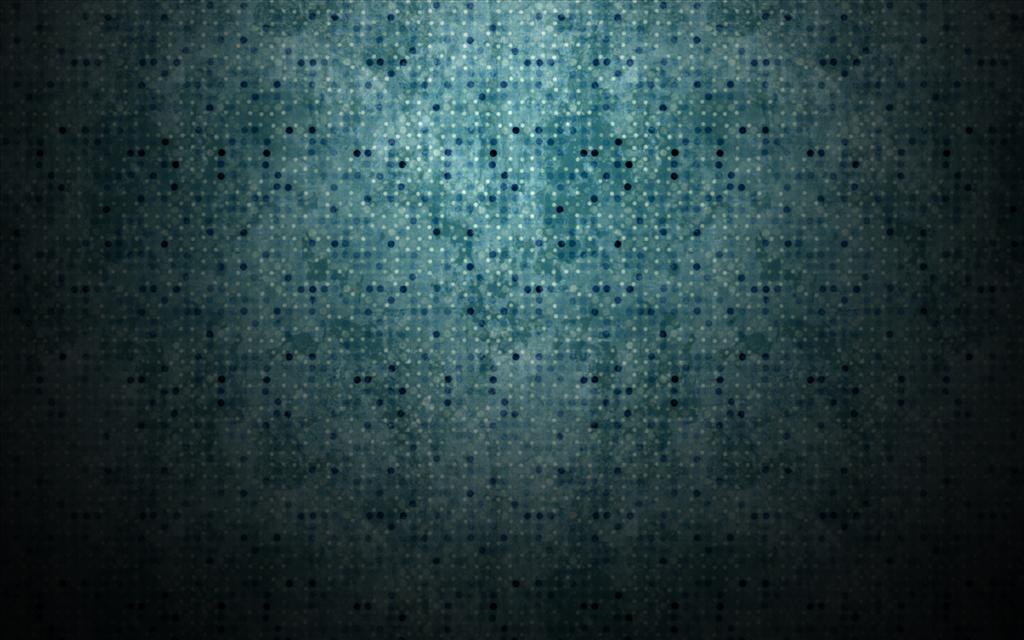
 La société ucratique
La société ucratique Encourager à une pratique méditative régulière ?
Encourager à une pratique méditative régulière ?

 par Vic le 20-01-2014 à 19H04
par Vic le 20-01-2014 à 19H04
 éducation par dionisos le 20-01-2014 à 19H36Voir le message
éducation par dionisos le 20-01-2014 à 19H36Voir le message Intérêt d'Ukratio par def le 20-01-2014 à 23H06Voir le message
Intérêt d'Ukratio par def le 20-01-2014 à 23H06Voir le message donner des cours par dionisos le 26-01-2014 à 06H51Voir le message
donner des cours par dionisos le 26-01-2014 à 06H51Voir le message Motivation et méditation par HDen31 le 27-01-2014 à 17H38Voir le message
Motivation et méditation par HDen31 le 27-01-2014 à 17H38Voir le message par Babeuf le 08-02-2014 à 17H48Voir le message
par Babeuf le 08-02-2014 à 17H48Voir le message Ne pas se limiter à une forme de méditation. par MissedClic le 16-06-2014 à 23H21Voir le message
Ne pas se limiter à une forme de méditation. par MissedClic le 16-06-2014 à 23H21Voir le message